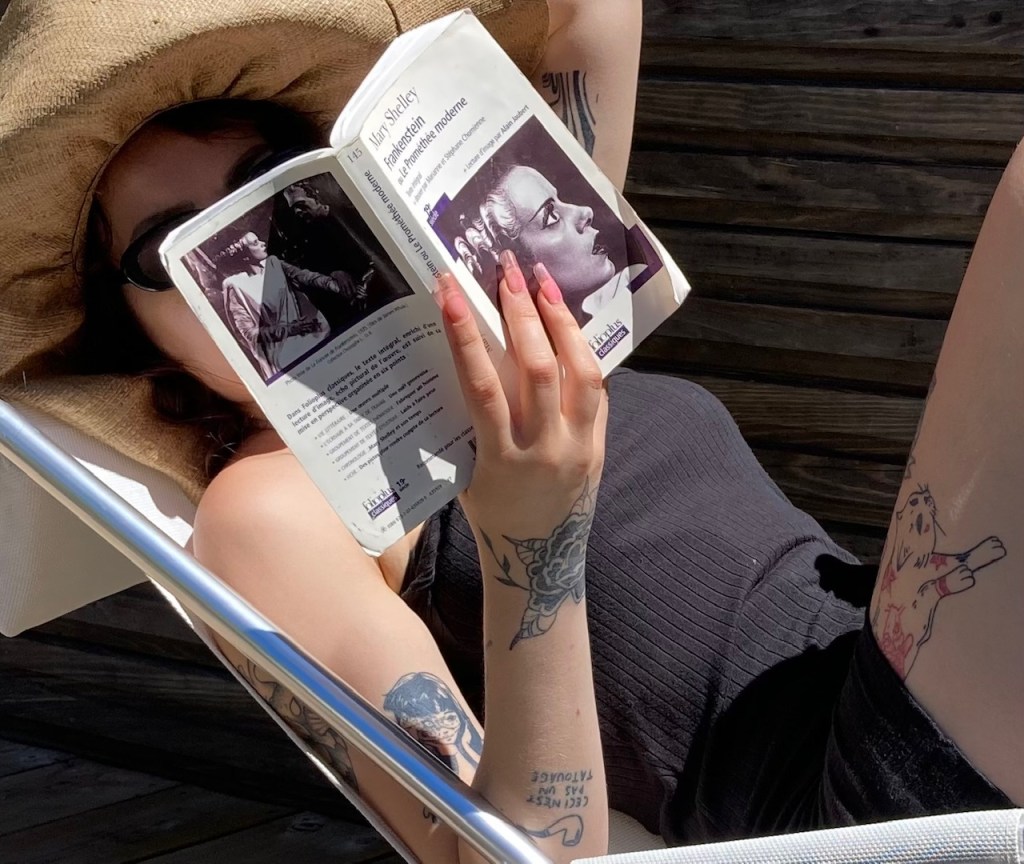A 9 ans, le petit Gustave Flaubert écrit à son grand ami, Ernest Chevalier, cette lettre. Nous sommes le 31 décembre 1830, le moment pour exprimer ses vœux et ses souhaits pour l’année à venir : « Si tu veux nous associers pour écrire moi, j’écrirait des comédies et toi tu écriras tes rêves ; et comme il y une dame qui vient chez papa et qui nous contes toujours des bêtises je les écrirait. » (l’orthographe est respectée). La dame en question est Julie, la bonne des Flaubert, qui servira de modèle pour un cœur simple.
C’est une belle chose qu’un souvenir ; c’est presque un désir qu’on regrette. (15 Mars 1842). Le résumé de l’Education Sentimentale (1re version achevée 3 ans plus tard)
Alors qu’il écrit Madame Bovary, Gustave Flaubert va nouer une relation amoureuse, intellectuelle et, pour notre bonheur, épistolaire, avec la poétesse Louise Collet. Ces lettres sont un véritable traité d’écriture, le manifeste du roman moderne. Ma Lili, médite chacune de ses phrases, avant de prendre ta plume.
On arrive au style qu’avec un labeur atroce, avec une opiniâtreté fanatique et dévouée. (15.08.1846 à Louise Collet)
Quand je lis Shakespeare je deviens plus grand, plus intelligent et plus pur.
Serre ton style, fais-en un tissus souple comme la soie et fort comme une cotte de mailles.
Travaille chaque jour patiemment un nombre d’heures égales. Prend le plis d’une vie studieuse et calme ; tu y goûteras d’abord un grand charme et tu en tireras de la force. J’ai eu aussi la manie de passer des nuits blanches ; ça ne mène à rien qu’à vous fatiguer. (le 24 avril 1852 F. écrit à LC, « Avant hier je me suis couché à 5 heures du matin, et hier à 3 heures ». sic)
Il faut se méfier de tout ce qui ressemble à de l’inspiration.
J’écris pour moi, pour moi seul, comme je fume et comme je dors. (16.08.1846)
La phrase ne coule plus, je l’arrache et elle me fait du mal en sortant. (octobre 1847 L.C.)
L’art, au bout du compte, n’est pas plus sérieux que le jeu de quilles. (1851 début de la rédaction de Madame Bovary) LC
Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet… 1852 LC
Nul lyrisme, pas de réflexions, personnalité de l’auteur absente. Ce sera triste à lire ; il y aura des choses atroces de misères et de fétidité. 1852 LC, toujours à propos de MB.
Je suis un homme-plume. 1852 LC
J’ai le regard penché sur les mousses des moisissures de l’âme. 1852 LC
Toute la valeur de de mon livre, s’il en a une, sera d’avoir sur marcher droit sur une cheveux, suspendu entre le double abîme du lyrisme et du vulgaire. 1852 LC
…Il n’y a rien de plus faible que de mettre en art ses sentiments personnels. 1852 LC
J’ai fini ce soir de barbouiller la première idée de mes rêves de jeune fille. J’en ai encore pour quinze jours à naviguer sur ces lacs bleus, après quoi j’irais au bal et passerai ensuite un hiver pluvieux, que je clorai par une grossesse. 27 mars 1852 LC
Maintenant par combien d’études il faut passer pour se dégager des livres, et qu’il en faut lire ! Il faut boire des océans et les repisser. 1852
… Il faut se dégager de l’archaïsme, du mot commun, avoir des idées contemporaines dans leurs mauvais termes, et que ce soit clair comme du voltaire, touffu comme tu Montaigne, nerveux comme du La Bruyère et ruisselant de couleur, toujours. 1852
Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, inchangeable, aussi rythmée, aussi sonore . juillet 1852
Médite donc plus avant d’écrire et attache toi au mot. Tout le talent d’écrire ne consiste après tout que dans le choix des mots. C’est la précision qui fait la force. Il en est en style comme en musique : ce qu’il y a de plus beau et de plus rare c’est la pureté du son. Juillet 1852
Serre, serre, que chaque mot porte. Idem
J’aurais connu vos douleurs, pauvre âmes obscures, humides de mélancolie renfermée, comme vos arrière-cours de province, dont les murs ont de la mousse. Septembre 1852
Les citations sont extraites de sa correspondance, sélectionnée par Geneviève Bollème (1927-2005) Dans Préface à la vie d’Ecrivain Ed. du Seuil. Ouvrage non réédité malheureusement.